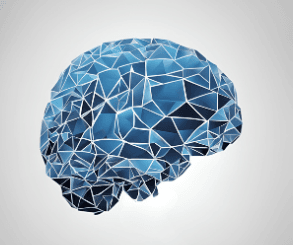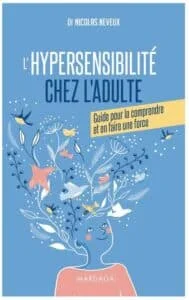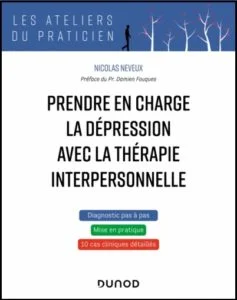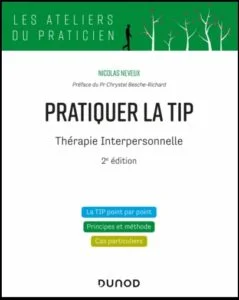Deuil: comment le surmonter?
Vous voulez en savoir plus sur le deuil ? Vous êtes sur la bonne page ! Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour identifier et savoir réagir face au deuil.
Rédacteur « deuil » : Dr Nicolas Neveux, Psychiatre à Paris, formé en Thérapie Cognitive et Comportementale (AFTCC) et en Thérapie Interpersonnelle (IFTIP), mail: dr.neveux@gmail.com; prendre rendez-vous
Sources: L’hypersensibilité chez l’adulte, Mardaga; Pratiquer la Thérapie Interpersonnelle (TIP), Dunod; Prendre en charge la dépression avec la thérapie interpersonnelle, Dunod.
L’essentiel :
- Le deuil est une réaction normale à une perte, mais peut devenir pathologique s’il s’installe dans la durée ou s’accompagne de symptômes graves.
- Un médecin ou psychiatre doit évaluer la situation et proposer une prise en charge adaptée.
- Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) et les thérapies interpersonnelles (TIP) sont efficaces pour accompagner le deuil compliqué. La TIP notamment identifie spécifiquement un axe de travail sur le deuil.
Le deuil : définition, mécanismes et enjeux psychologiques
Le deuil désigne l’ensemble des réactions psychologiques, émotionnelles, physiques et sociales qui surviennent à la suite d’une perte significative. Il peut s’agir du décès d’un proche, mais aussi d’une séparation, d’un licenciement, d’une maladie chronique, ou encore de la perte d’un animal de compagnie. Le deuil est un processus universel, mais son vécu est unique à chaque individu.
Les phases du deuil : un modèle évolutif
Le modèle le plus connu est celui d’Elisabeth Kübler-Ross, psychiatre suisse, qui a décrit cinq phases du deuil : le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l’acceptation. Cependant, il est important de souligner que ces phases ne sont pas linéaires et que chaque personne peut les vivre dans un ordre différent, ou même revenir en arrière.
Exemple clinique :
Madame L., 58 ans, a perdu son mari après 30 ans de mariage. Pendant les premiers mois, elle refusait de croire à sa disparition, rangeant ses affaires comme s’il devait revenir. Puis, elle a ressenti une colère intense envers les médecins, avant de sombrer dans un état dépressif marqué par un repli sur soi et une perte d’appétit. Après un accompagnement en thérapie interpersonnelle, elle a progressivement pu évoquer des souvenirs positifs et envisager un avenir sans son conjoint.
Les phases du deuil selon Fauré
Dans le Processus du Deuil il existe selon Christophe Fauré : Quatre Phases Clés.
Le psychiatre Christophe Fauré a formalisé le deuil comme un processus de cicatrisation psychique se déroulant en quatre étapes fondamentales. La compréhension de ces phases est cruciale pour l’endeuillé et son entourage.
1. Le Choc et la Sidération : L’Ultime Solitude
Le deuil s’amorce par la rupture violente du lien émotionnel. La personne est plongée dans un état de choc et de sidération ; la réalité de la perte est si inconcevable qu’elle génère un sentiment d’isolement profond.
Même au milieu de ses proches, l’endeuillé a l’impression d’une ultime solitude. Fauré insiste sur le fait que cette difficulté à se rejoindre dans la peine n’est pas un manque d’amour ou d’empathie, mais la manifestation que chaque personne vit le deuil de façon singulière. Ce processus ramène l’individu au cœur de soi-même.
Face à cette douleur immense, des mécanismes de protection psychique se mettent naturellement en place, créant une distance salvatrice. L’endeuillé peut se sentir en mode automatique, déconnecté de ses émotions, comme s’il bénéficiait d’un « droit de deuil ». Bien que nécessaire à la survie psychique immédiate, cet état est souvent éphémère et difficilement compris par l’entourage. Durant cette phase, la colère est également fréquente, notamment dirigée contre les proches qui se sentent démunis face à la souffrance.
2. La Fuite, la Recherche, puis l’Épuisement (La Longue Course)
La deuxième étape, que Fauré nomme la phase de fuite/recherche/fuite, peut s’étendre sur une longue durée.
Bien que conscient du décès, l’individu est confronté à un tsunami de souffrance. Il tente d’y échapper, de « courir suffisamment vite » pour ne pas être submergé, ce qui se traduit par une grande agitation extérieure ou un stress intense intériorisé.
Une métaphore décrivant bien cet état est celle du ventilateur qui continue de tourner quelque temps après que le courant (la mort) ait été coupé. Durant cette phase, l’endeuillé s’attache à pérenniser la relation avec le disparu. Il cherche à maintenir sa présence dans le monde par le biais d’objets (photos, vêtements), de rituels et de commémorations. Ce comportement n’est absolument pas pathologique ; il est normal, bénéfique et souvent nécessaire pour faire la transition.
3. La Confrontation à l’Absence et le Double Visage
La troisième étape marque un tournant douloureux : l’individu réalise que « l’électricité est coupée » et que le lien, tel qu’il existait, n’est plus. C’est la prise de conscience profonde du grand manque.
Malgré des efforts considérables pour s’adapter et « aller bien » pendant des mois (par exemple, donner quelques souvenirs), la dure réalité le rattrape. Alors que le soutien initial de l’entourage s’amenuise, l’endeuillé adopte souvent un double visage : une façade affichée au monde (sourire, participation à des activités) et une réalité intérieure totalement déconnectée et souffrante (incapacité de sortir du lit deux jours plus tard).
Cette impression de perdre le mode d’emploi de sa vie, d’être constamment dans le semblant, est extrêmement coûteuse en énergie et peut durer d’un à plusieurs années, selon l’intensité de la relation perdue. Si cette phase s’éternise, elle peut être qualifiée de « vécu dépressif », car elle partage des symptômes avec la dépression. Cependant, Fauré insiste sur le fait qu’il s’agit avant tout d’un chagrin intense lié à la perte et au besoin d’apprivoiser l’absence. L’alternance de ces états est source d’un épuisement physique et psychologique sévère.
Le Rôle Crucial de l’Entourage : Un Kit de Survie Relationnelle
Durant ces phases, l’entourage a un rôle vital, agissant comme un kit de survie relationnelle.
-
Le Droit de Parler : Il est fondamental d’inviter l’endeuillé à parler de l’être cher disparu en toute objectivité. Le partage des souvenirs, même s’il provoque des larmes (comparable au retrait d’un pansement nécessaire à la cicatrisation), permet d’estomper progressivement la charge émotionnelle douloureuse.
-
Les Circonstances du Décès : Aborder les circonstances du décès est également important. L’endeuillé revit souvent ces moments ; pouvoir les partager et les reformuler l’aide à prendre de la distance.
-
Santé Physique : Le deuil s’inscrit dans le corps. La souffrance psychique a un impact direct sur la santé physique et les défenses immunitaires, provoquant fatigue et épuisement. S’intéresser à l’alimentation, au sommeil et encourager l’endeuillé à sortir et à marcher est essentiel pour qu’il prenne soin de lui.
-
Le Réseau de Soutien : Le maintien d’un réseau de soutien de qualité est capital. Avoir un témoin de sa peine, une écoute bienveillante, participe à l’apaisement, même si l’autre se sent impuissant à faire disparaître la douleur.
-
La Dimension Spirituelle : Le deuil est aussi un cheminement spirituel. Il peut être bénéfique d’aborder la recherche de sens ou de réconfort dans une tradition, une philosophie ou une bienveillance intérieure.
-
Gérer les Émotions : Il est primordial de donner de l’espace à l’expression des émotions complexes qui se mêlent : culpabilité, injustice, tristesse. La différence homme-femme doit être comprise : l’homme cherche souvent une action concrète, tandis que pour la femme, le simple fait de parler a une valeur en soi. Cette divergence est souvent source de solitude dans le couple.
4. La Restructuration et la Reconstruction : Retrouver la Musique Légère
La quatrième et dernière étape, celle de la restructuration, voire de la reconstruction, ne peut advenir que si l’endeuillé a pris soin de sa « cicatrice » tout au long du processus.
Fauré utilise la métaphore d’une chaîne hi-fi : la douleur est un concert de hard rock assourdissant, mais une petite musique légère de Mozart existe déjà, jouant très doucement en arrière-plan. La guérison consiste à tendre l’oreille à cette musique et à monter progressivement le son, en s’éloignant du bruit violent de la souffrance.
Cette phase d’effacement de la douleur la plus aiguë est le moment où la personne se redéfinit. Elle apprend à vivre non plus malgré la mort, mais à travers elle, en acceptant la blessure avec bienveillance. L’objectif n’est pas d’oublier, mais d’honorer la mémoire du disparu en se reconnectant à soi-même et à la vie, en permettant à la « petite musique » de prendre une place significative.
Les manifestations du deuil
Le deuil se manifeste de multiples façons :
– Sur le plan émotionnel : tristesse, culpabilité, anxiété, colère, sentiment de vide.
– Sur le plan physique : fatigue, troubles du sommeil, douleurs, perte ou prise de poids.
– Sur le plan cognitif : difficultés de concentration, confusion, pensées intrusives.
– Sur le plan comportemental : évitement des situations rappelant la perte, recherche de proximité avec des objets ou lieux liés au défunt.
Exemple clinique :
Monsieur T., 42 ans, a perdu sa sœur dans un accident de voiture. Il a développé des insomnies, des cauchemars récurrents, et évitait de conduire. En thérapie, il a pu exprimer sa culpabilité de ne pas avoir été présent ce jour-là, et a progressivement repris le volant grâce à des techniques de désensibilisation.
Deuil normal vs deuil pathologique : comment faire la différence ?
Il est essentiel de distinguer le deuil normal, qui fait partie du processus naturel d’adaptation, du deuil compliqué ou pathologique, qui nécessite une prise en charge spécifique.
Critères du deuil normal
Un deuil est considéré comme normal lorsqu’il évolue vers une acceptation progressive de la perte, malgré la persistance de la douleur. Les symptômes s’atténuent généralement après 6 à 12 mois, même si des pics de tristesse peuvent survenir à des dates anniversaires.
Signes d’un deuil pathologique
On parle de deuil pathologique lorsque :
– Les symptômes persistent au-delà d’un an sans amélioration.
– La personne est incapable de reprendre ses activités quotidiennes.
– Il y a une idéalisation excessive du défunt ou, à l’inverse, une colère persistante envers lui.
– Des symptômes dépressifs majeurs apparaissent (idées suicidaires, perte totale de plaisir, ralentissement psychomoteur).
– La personne développe des troubles anxieux (attaques de panique, phobies).
Exemple clinique :
Madame R., 34 ans, n’a pas pu retourner au travail après la mort de son père, survenue deux ans plus tôt. Elle passait ses journées à regarder des photos de lui, refusant de trier ses affaires. Elle présentait aussi des crises d’angoisse à l’idée de « l’oublier ». Un diagnostic de deuil compliqué a été posé, et une prise en charge combinant TCC et antidépresseurs a été initiée.
Les facteurs de risque de deuil compliqué
Certains facteurs augmentent le risque de développer un deuil pathologique :
– Nature de la perte : décès brutal, suicide, disparition non résolue.
– Relation avec le défunt : relation ambivalente, dépendance affective.
– Antécédents psychiatriques : dépression, troubles anxieux, traumatismes antérieurs.
– Manque de soutien social : isolement, absence de réseau familial ou amical.
– Événements de vie stressants : cumul de pertes, difficultés financières.
Exemple clinique :
Monsieur D., 60 ans, a perdu sa femme dans un attentat. Il avait déjà été suivi pour un trouble de stress post-traumatique après un accident de travail. Son deuil s’est compliqué d’un syndrome dépressif sévère, nécessitant une hospitalisation et une prise en charge pluridisciplinaire.
Prise en charge du deuil : quand et comment consulter ?
Il est recommandé de consulter un médecin/psychiatre lorsque le deuil impacte significativement la qualité de vie, ou en cas de signes de deuil pathologique.
Les approches thérapeutiques validées
– Thérapies cognitivo-comportementales (TCC) : elles aident à identifier et modifier les pensées dysfonctionnelles liées à la perte, et à réduire les comportements d’évitement.
– Thérapies interpersonnelles (TIP) : elles se concentrent sur les relations et les rôles sociaux, aidant la personne à restaurer ses liens avec les autres. Le deuil est l’un des 4 axes fondamentaux de la TIP, avec des techniques particulières.
– Thérapies de groupe : le partage avec d’autres endeuillés peut briser l’isolement et normaliser les émotions.
– Médicaments : les antidépresseurs peuvent être prescrits en cas de dépression associée.
Exemple clinique :
Madame S., 28 ans, a perdu son enfant en couches. Elle a intégré un groupe de parole pour parents endeuillés, ce qui lui a permis de mettre des mots sur sa culpabilité et de recevoir le soutien de personnes vivant la même épreuve. En parallèle, une TCC l’a aidée à gérer ses crises d’angoisse.
Le rôle des proches
Les proches jouent un rôle crucial dans l’accompagnement du deuil. Il est important d’écouter sans juger, d’accepter les silences, et d’éviter les phrases toutes faites (« Il faut tourner la page », « C’est la volonté de Dieu »). Proposer une présence régulière, sans forcer la personne à parler, est souvent la meilleure aide.
Le deuil chez l’enfant et l’adolescent : spécificités et accompagnement
Les enfants et adolescents vivent le deuil différemment des adultes. Leur compréhension de la mort évolue avec l’âge, et leurs réactions peuvent être plus fluctuantes.
Comprendre la mort selon l’âge
– Avant 5 ans : la mort est souvent perçue comme réversible (« Papa va revenir »).
– Entre 5 et 9 ans : la mort est comprise comme définitive, mais peut être associée à des peurs (contagion, culpabilité).
– À partir de 10 ans : la compréhension est proche de celle de l’adulte, avec une capacité à verbaliser la tristesse.
Exemple clinique :
Léo, 7 ans, a perdu sa mère. Il dessine souvent des monstres et dit qu’elle est « partie en voyage ». En thérapie, il a pu exprimer sa peur d’être abandonné par son père, et a progressivement accepté l’idée de la mort grâce à des métaphores adaptées à son âge.
Signes d’alerte chez l’enfant
Il faut consulter si l’enfant présente :
– Un repli sur soi prolongé.
– Des troubles du comportement (agressivité, fugues).
– Une baisse brutale des résultats scolaires.
– Des symptômes physiques inexpliqués (maux de ventre, maux de tête).
Le deuil et les rituels : leur importance dans le processus
Les rituels (funérailles, commémorations, objets transitionnels) jouent un rôle clé dans le deuil. Ils permettent de marquer la réalité de la perte, de dire au revoir, et de créer un lien symbolique avec le défunt.
Exemple clinique :
La famille de Sophie, 12 ans, a organisé un lâcher de ballons en mémoire de sa sœur. Ce rituel a aidé Sophie à extérioriser sa tristesse et à se sentir soutenue par sa famille.
Conclusion : vivre avec l’absence
Le deuil n’est pas une maladie, mais un processus douloureux et nécessaire. Il ne s’agit pas d’oublier, mais d’apprendre à vivre avec l’absence. Une prise en charge précoce et adaptée permet d’éviter les complications et de retrouver un équilibre de vie.
Si vous ou un proche traversez un deuil difficile, n’hésitez pas à consulter un professionnel. Vous n’êtes pas seul.
Venir au cabinet
Dr Neveux Nicolas, 9 rue Troyon, Paris; tél: 0609727094
- Métro: Station Charles de Gaulle Etoile (ligne 6 depuis Paris 7-14-15-16; ligne 2 depuis Paris 17; ligne 1 depuis Paris 1-2-8, Neuilly sur Seine, La Défense, Nanterre).
- RER: Station Charles de Gaulle Etoile (RER A depuis La Défense, Nanterre, Paris 8, Paris 1-4-11, Rueil, Maisons Laffitte, Le Vésinet etc…).
- Bus: Station Charles de Gaulle Etoile (lignes 22-30-52 depuis Paris 75016; ligne 92 depuis Paris 75007, 75014, 75015; lignes 30-31-92-93 depuis Paris 75017; ligne 73 depuis Neuilly sur Seine; lignes 22-52-73 depuis Paris 8; ligne 92 depuis Levallois).
Fait à Paris 16 par un psychiatre et un psychologue.
Auteur
Mail: dr.neveux@gmail.com (à privilégier+++)
Tél: 0609727094 (laisser un message)
Au cabinet: 9 rue Troyon 75017 Paris
NB: Pas de consultation par mail ou téléphone. Les messages ne sont pas consultés hors jours et heures ouvrables. En cas d’urgence, contacter le SAMU (15)