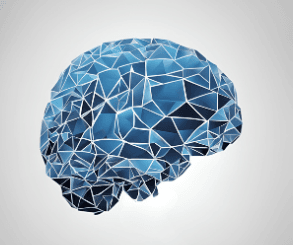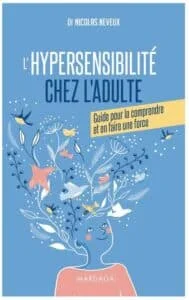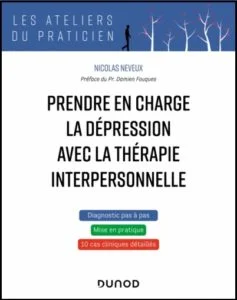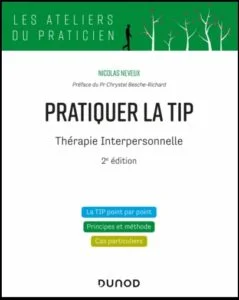Risques psychosociaux (RPS): reconnaître et gérer
Vous voulez en savoir plus sur les risques psychosociaux (RPS)? Vous êtes sur la bonne page! Vous trouverez ici toutes les informations nécessaires pour identifier et savoir vous protéger face aux risques psychosociaux (RPS). Cette page fait partie du grand dossier sur le burn-out et la souffrance au travail.
Rédacteur: Dr Nicolas Neveux, Psychiatre à Paris, formé en Thérapie Cognitive et Comportementale (AFTCC) et en Thérapie Interpersonnelle (IFTIP),
mail: dr.neveux@gmail.com
Sources: Pratiquer la Thérapie Interpersonnelle (TIP), Dunod; Prendre en charge la dépression avec la thérapie interpersonnelle, Dunod.
L’essentiel:
- Peut être un symptôme de pathologies graves (troubles anxieux, dépression…).
- Un médecin/psychiatre doit faire le diagnostic et coordonner la prise en charge.
- La TCC et la TIP sont les traitement indiqués en première intention.
- La prévention ou les interventions doivent être organisées par des structures aguerries, de préférence par des psychiatres ou des psychologues qui sont à même de prendre en charge la souffrance mentale. Les meilleurs sociétés de prévention des RPS sont celles qui proposent des prestations basées sur la TCC et la TIP (comme par exemple F.I. Science, dont les approches viennent de ces psychothérapies).
Autres pages du dossier sur la souffrance au travail et le burnout
- Généralités
- Risques psycho-sociaux
- Souffrance au travail
- Modèles du burnout
- Comment repérer le burnout?
- Burnout : comment reconnaître ses signes ?
- Traitement du burnout
- TCC du burnout
Qu’est-ce que les risques psychosociaux (RPS) ?
Les risques psychosociaux (RPS) désignent l’ensemble des situations professionnelles ou personnelles qui peuvent nuire à la santé mentale, physique et sociale des individus. Ils résultent souvent d’une combinaison de facteurs organisationnels, relationnels et individuels. Selon l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, les RPS incluent le stress chronique, les violences internes ou externes, le harcèlement moral ou sexuel, l’épuisement professionnel (burn-out), mais aussi les conflits de valeurs ou la souffrance éthique.
Exemple clinique :
Madame L., 42 ans, cadre dans une grande entreprise, consulte pour des crises d’angoisse, des insomnies et une perte de motivation. Elle décrit un environnement de travail où les objectifs sont constamment revus à la hausse, sans reconnaissance de ses efforts. Elle se sent isolée, craignant de perdre son emploi si elle exprime ses difficultés. Après évaluation, son médecin diagnostique un syndrome d’épuisement professionnel lié à des RPS.
Les six grandes catégories de RPS
Les RPS peuvent être classés en six grandes catégories, selon le modèle de l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) : 1. Le stress au travail : Déséquilibre entre les exigences professionnelles et les ressources disponibles pour y faire face.
2. Les violences internes : Conflits, harcèlement moral ou sexuel entre collègues ou avec la hiérarchie.
3. Les violences externes : Agressions verbales ou physiques de la part de clients, usagers ou publics.
4. Le burn-out : État d’épuisement physique, émotionnel et mental lié à un investissement professionnel prolongé et non récompensé.
5. Les conflits de valeurs : Situation où le salarié est contraint d’agir contre ses principes éthiques ou moraux.
6. La souffrance éthique : Sentiment de ne pas pouvoir accomplir son travail de manière conforme à ses valeurs professionnelles.
Impact des RPS sur la santé
Les conséquences des RPS sont multiples et peuvent toucher aussi bien la santé mentale que physique. Parmi les troubles les plus fréquents, on retrouve :
– Troubles anxieux (attaques de panique, anxiété généralisée, burn-out)
– Dépression (épisode dépressif caractérisé, dysthymie)
– Troubles du sommeil (insomnies, réveils nocturnes)
– Troubles musculo-squelettiques (TMS) liés au stress chronique
– Maladies cardiovasculaires (hypertension, infarctus)
– Troubles digestifs (syndrome de l’intestin irritable, ulcères)
Exemple clinique :
Monsieur T., 50 ans, infirmier en service de réanimation, présente depuis plusieurs mois des douleurs thoraciques, des palpitations et une irritabilité marquée. Il décrit un sentiment d’impuissance face à la charge de travail et à la souffrance des patients. Après bilan, son cardiologue évoque un lien entre son hypertension récente et le stress professionnel chronique.
Les causes et facteurs de risques psychosociaux
Les RPS ne sont jamais le fruit d’une seule cause, mais résultent de l’interaction entre plusieurs facteurs. On distingue généralement trois grandes catégories de facteurs :
Facteurs liés à l’organisation du travail
– Surcharge de travail : Objectifs irréalistes, délais trop courts, accumulation des tâches.
– Manque d’autonomie : Contrôle excessif, absence de marge de manœuvre dans l’exécution des tâches.
– Manque de reconnaissance : Absence de feedback positif, salaires ou promotions injustes.
– Insécurité de l’emploi : Précarité, restructurations fréquentes, menaces de licenciement. Exemple clinique :
Sophie, 35 ans, enseignante, consulte pour un état dépressif. Elle explique que depuis la réforme de son établissement, elle doit gérer des classes surchargées, des programmes en constante évolution, et un manque de soutien de la part de sa hiérarchie. Elle se sent « usée » et « inutile ».
Facteurs liés aux relations de travail
– Conflits interpersonnels : Tensions avec les collègues ou la hiérarchie.
– Harcèlement moral ou sexuel : Comportements humiliants, intimidations, propos ou gestes dégradants.
– Manque de soutien social : Isolement, absence de solidarité entre collègues. Exemple clinique :
Julien, 28 ans, commercial, présente des symptômes de stress post-traumatique après avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur. Il décrit des remarques dévalorisantes, des tâches impossibles à réaliser, et une exclusion progressive de l’équipe.
Facteurs individuels et extra-professionnels
– Vulnérabilités personnelles : Antécédents de troubles psychiatriques, faible estime de soi.
– Événements de vie stressants : Divorce, deuil, problèmes financiers.
– Déséquilibre vie professionnelle/vie privée : Difficulté à déconnecter, intrusion du travail dans la sphère personnelle. Exemple clinique :
Claire, 40 ans, manager, consulte pour un burn-out. Elle explique qu’en plus d’un travail très exigeant, elle doit s’occuper seule de ses deux enfants et de son père âgé. Elle n’a plus de temps pour elle et se sent « au bord de la rupture ».
Comment identifier les risques psychosociaux ?
L’identification des RPS repose sur une approche pluridisciplinaire, associant l’analyse des conditions de travail, l’écoute des salariés et l’évaluation médicale.
Signes d’alerte individuels
Chez un individu, les RPS peuvent se manifester par :
– Symptômes physiques : Fatigue chronique, maux de tête, troubles digestifs, douleurs musculaires.
– Symptômes émotionnels : Irritabilité, tristesse, sentiment d’échec, perte de confiance en soi.
– Symptômes comportementaux : Absentéisme, baisse de productivité, isolement, consommation accrue d’alcool ou de médicaments. Exemple clinique :
Thomas, 55 ans, technicien, consulte pour des douleurs lombaires persistantes. À l’interrogatoire, il avoue boire trois bières chaque soir pour « décompresser » et avoir des difficultés à se lever le matin. Son médecin évoque un possible lien avec son travail, où il subit des pressions constantes pour augmenter sa productivité.
Signes d’alerte collectifs
Au niveau d’une équipe ou d’une entreprise, les RPS peuvent se traduire par :
– Taux d’absentéisme élevé : Augmentation des arrêts maladie, surtout pour des motifs psychologiques.
– Turn-over important : Départs fréquents, difficultés de recrutement.
– Climat social dégradé : Conflits ouverts, rumeurs, baisse de la coopération.
– Baisse de la qualité du travail : Erreurs répétées, retard dans les livraisons, insatisfaction client. Exemple clinique :
Dans une PME de 50 salariés, le médecin du travail note une augmentation de 30% des arrêts maladie en un an, principalement pour des troubles anxio-dépressifs. Une enquête révèle un management autoritaire, des objectifs inatteignables et une absence de dialogue social.
Outils d’évaluation des RPS
Plusieurs outils permettent d’évaluer les RPS, aussi bien au niveau individuel que collectif :
– Questionnaires standardisés : Karasek (demande/contrôle/soutien), Siegrist (déséquilibre effort/récompense), MBI (Maslach Burnout Inventory).
– Entretiens individuels : Avec le médecin du travail, le psychiatre ou le psychologue.
– Enquêtes de climat social : Questionnaires anonymes pour évaluer la perception des salariés.
– Analyse des indicateurs RH : Taux d’absentéisme, turn-over, nombre de conflits.
Prévention et prise en charge des risques psychosociaux
La prévention des RPS repose sur une approche globale, associant actions individuelles et collectives menées par des structures validées. Les actions doivent autant que possible être menées par des psychiatres ou des psychologues qui sont à même de prendre en charge la souffrance mentale. C’est capital vu le poids émotionnel et la complexité des mécanismes en jeu. De plus, il faut que les actions se réfèrent à des techniques ayant prouvé leur efficacité. Par exemple, F.I. Science propose des interventions basées sur la TCC et la TIP menées par des psychiatres notamment.
Prévention primaire : Agir sur les causes
L’objectif est de réduire ou d’éliminer les facteurs de risque à la source :
– Améliorer l’organisation du travail : Clarifier les rôles, équilibrer la charge de travail, favoriser l’autonomie.
– Former les managers : Sensibilisation aux RPS, formation à la gestion d’équipe, développement des compétences relationnelles.
– Encourager la participation : Impliquer les salariés dans les décisions, favoriser les espaces de dialogue.
– Promouvoir l’équilibre vie pro/vie perso : Horaires flexibles, télétravail, droit à la déconnexion. Exemple clinique :
Une entreprise de services informatiques met en place des ateliers de gestion du stress et des groupes de parole animés par un psychologue. En un an, le taux d’absentéisme diminue de 20% et la satisfaction des salariés s’améliore significativement.
Prévention secondaire : Dépister et prendre en charge précocement
Il s’agit d’identifier les premiers signes de RPS et d’agir rapidement :
– Formation des managers et des RH : Repérer les signes d’alerte, orienter vers les ressources appropriées.
– Cellule d’écoute et de soutien : Mise en place d’un numéro vert, d’un référent RPS, ou d’un partenariat avec des professionnels de santé mentale.
– Bilan de santé régulier : Intégrer une évaluation des RPS dans les visites médicales obligatoires. Exemple clinique :
Dans un hôpital, une cellule de soutien psychologique est créée pour les soignants. Après six mois, le nombre de burn-out déclarés diminue et le climat de travail s’améliore.
Prévention tertiaire : Prendre en charge les conséquences
Quand les RPS ont déjà des répercussions sur la santé, une prise en charge spécifique est nécessaire :
– Consultation médicale : Bilan somatique et psychologique, orientation vers un psychiatre ou un psychologue si nécessaire.
– Thérapies validées : Thérapies cognitivo-comportementales (TCC), thérapie interpersonnelle (TIP), EMDR pour les traumatismes.
– Aménagements du travail : Temps partiel thérapeutique, changement de poste, accompagnement au retour après un arrêt maladie.
– Soutien juridique : En cas de harcèlement ou de discrimination, accompagnement par un avocat spécialisé.
Exemple clinique :
Après un arrêt maladie pour dépression, Marie, 38 ans, bénéficie d’un temps partiel thérapeutique et d’une thérapie TCC. Progressivement, elle retrouve confiance en elle et peut reprendre son poste à temps plein.
Cadre légal et obligations de l’employeur
En France, la prévention des RPS est encadrée par le Code du travail. L’employeur a une obligation de sécurité de résultat envers ses salariés.
Obligations légales
– Évaluation des risques : L’employeur doit identifier et évaluer les RPS dans le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP).
– Actions de prévention : Mise en place de mesures pour réduire les risques identifiés.
– Information et formation : Sensibiliser les salariés et les managers aux RPS.
– Consultation des représentants du personnel : Le CSE (Comité Social et Économique) doit être consulté sur les questions de santé et de sécurité au travail.
Recours en cas de manquement
Si l’employeur ne respecte pas ses obligations, plusieurs recours sont possibles :
– Signalement à l’inspection du travail : En cas de danger grave et imminent.
– Action en justice : Pour faire reconnaître un préjudice lié aux RPS (ex : burn-out, harcèlement).
– Recours aux prud’hommes : En cas de licenciement abusif ou de discrimination.
Exemple clinique :
Un salarié victime de harcèlement moral porte plainte contre son employeur. Après expertise, le tribunal reconnaît la responsabilité de l’entreprise et condamne celle-ci à verser des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Risques psychosociaux : quelles solutions pour les salariés ?
Face aux RPS, les salariés ne sont pas démunis. Plusieurs pistes peuvent être explorées pour se protéger et agir.
Se protéger au quotidien
– Fixez des limites : Apprenez à dire non, déconnectez-vous en dehors des heures de travail.
– Développez un réseau de soutien : Parlez à vos collègues, à votre famille, ou à un professionnel.
– Pratiquez des activités ressourçantes : Sport, méditation, hobbies pour évacuer le stress.
– Consultez un professionnel : Médecin du travail, psychiatre, psychologue, sophrologue.
Agir collectivement
– Soutenez les initiatives syndicales : Participez aux actions pour améliorer les conditions de travail.
– Utilisez les canaux de dialogue : CSE, boîtes à idées, enquêtes internes.
– Signalez les dysfonctionnements : Utilisez les procédures de signalement des RPS si elles existent.
Que faire en cas de crise ?
Si vous êtes en situation de crise (burn-out, dépression, idées suicidaires) :
– Consultez en urgence : Médecin traitant, psychiatre, service d’urgence psychiatrique.
– Contactez un numéro d’écoute : Fil Santé Jeunes (pour les jeunes), SOS Amitié, Suicide Écoute.
– Demandez un arrêt de travail : Si nécessaire, pour vous protéger et vous soigner. Exemple clinique :
Après un épisode de pleurs incontrôlables au travail, Élodie, 30 ans, consulte son médecin qui lui prescrit un arrêt de travail et une thérapie. Elle contacte aussi le service de santé au travail pour signaler la situation et demander un aménagement de poste.
Risques psychosociaux : ressources et contacts utiles
Pour aller plus loin, voici une liste de ressources et de contacts utiles : – INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité) : [www.inrs.fr](https://www.inrs.fr)
– ANACT (Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail) : [www.anact.fr](https://www.anact.fr)
– Ministère du Travail : [travail-emploi.gouv.fr](https://travail-emploi.gouv.fr)
– Numéros utiles : – SOS Amitié : 09 72 39 40 50 – Fil Santé Jeunes : 0800 235 236 – Suicide Écoute : 01 45 39 40 00
Conclusion : les risques psychosociaux, une réalité à ne pas négliger
Les risques psychosociaux (RPS) sont une réalité complexe, aux conséquences graves pour les individus et les organisations. Leur prévention passe par une prise de conscience collective, une volonté politique et managériale, et des actions concrètes sur le terrain. Chaque acteur – employeur, salarié, médecin, institution – a un rôle à jouer pour créer des environnements de travail sains et respectueux de la santé mentale. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ou si vous observez des signes de RPS autour de vous, n’hésitez pas à en parler et à chercher de l’aide. Les RPS ne sont pas une fatalité : des solutions existent, et la première étape est souvent la plus difficile – mais aussi la plus libératrice.
Auteur
Mail: dr.neveux@gmail.com (à privilégier+++)
Tél: 0609727094 (laisser un message)
Au cabinet: 9 rue Troyon 75017 Paris
NB: Pas de consultation par mail ou téléphone. Les messages ne sont pas consultés hors jours et heures ouvrables. En cas d’urgence, contacter le SAMU (15)